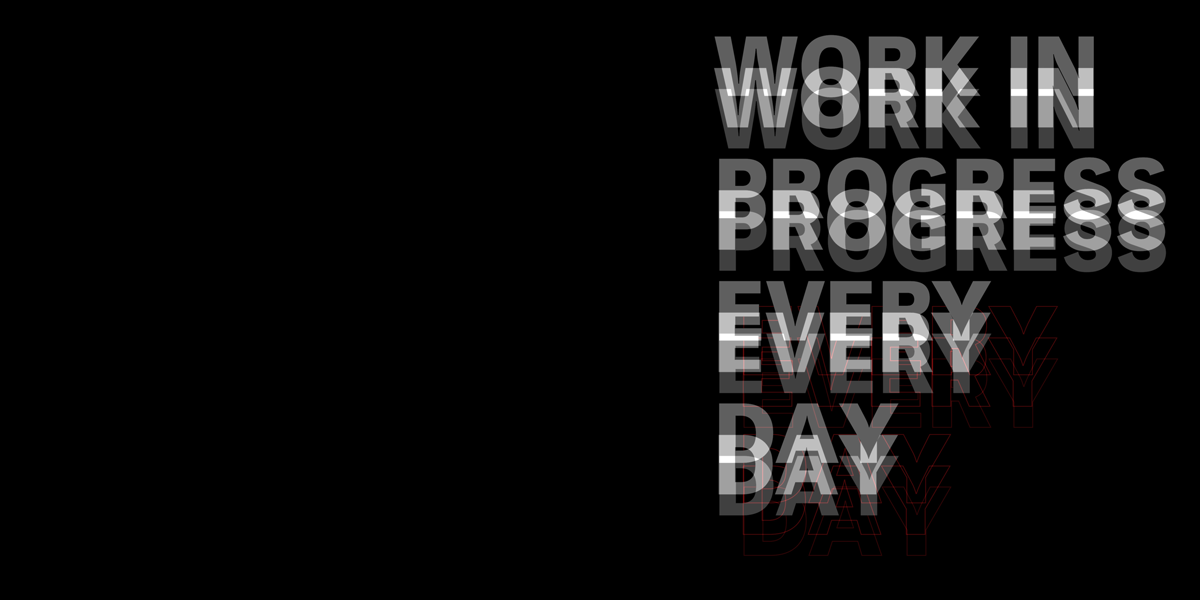Work in Progress se compose de plusieurs volets, qui explorent chacun une étape du lien entre ton idée de départ et sa concrétisation. Le processus de création est vivant : il avance par phases d’inspiration, de réflexion, d’essais, d’erreurs et de découvertes — autant de moments essentiels qui construisent ton projet.
Starter, pour bien démarrer
Toute création démarre par une phase de préparation. Il s’agit d’un temps de recherche, d’observation et d’immersion dans un sujet, un univers, ou une problématique.
Cette première phase peut prendre plusieurs formes : une veille sur un thème, une rencontre avec une œuvre, une visite de musée, ou encore l’exploration de ses souvenirs et expériences personnelles.
Rien ne se crée pas de rien, créer, c’est associer, transformer ou détourner des éléments existants. C’est pourquoi cette étape est essentielle pour nourrir ta créativité et orienter tes recherches. Elle mobilise ta capacité à faire émerger plusieurs idées à partir d’une même sollicitation.
Questions pour amorcer ta réflexion :
- Quelle est ton idée de départ, ton thème, ton envie ?
- Qu’est-ce que tu veux faire ressentir ou questionner ?
- Quelles références artistiques t’inspirent (artistes, œuvres, démarches, mouvements) ?
- Qu’est-ce qui, dans ces références, résonne avec ton projet (thème, forme, sens) ?
Pour clarifier tes idées, prends le réflexe de dessiner un schéma autour d’une idée centrale, d’un thème. Tu peux aussi puiser une incitation dans cette liste* pour surmonter un blocage et explorer librement de nouvelles pistes. Cette méthode (mind mapping) stimule la pensée divergente et permet de clarifier les tenants et aboutissants de ton projet.
Mind Mapping
Formule ton intention sous la forme d’une phrase ou d’une question simple et personnelle, puis associe-y quelques mots-clés essentiels.
Par exemple, la question : « Les choix plastiques traduisent-ils le sens que l’artiste veut donner à son œuvre ? » peut servir de point de départ pour construire une carte mentale organisée autour de deux axes principaux :
Du point de vue plastique :
- médium, matériaux : dessin, peinture, sculpture, photo, vidéo, installation, collage, etc. Ce choix, qu’apporte-t-il visuellement ?
- procédé, technique : Quelle expérience sensible cela crée-t-il ?
- format, échelle, rapport au spectateur…
- notions plasticiennes convoquées : Une tension significative est-elle ? Peux-tu expliquer ?
- références artistiques : Que fait l’artiste ? Comment ? Pourquoi ? Qu’est-ce que tu en retiens ? Comment leur travail influence-t-il ton approche plastique ?
Du point de vue sémantique :
- sujet, thème : Que veux-tu aborder ? (identité, nature, mémoire, société, émotions, etc.)
- intention personnelle : Pourquoi ce sujet te touche-t-il ? Quelle expérience ou réflexion personnelle y est liée ?
- message, interprétation : Que veux-tu faire ressentir, comprendre, questionner ? Quelle réaction attends-tu du spectateur ?
- références conceptuelles : courants artistiques, artistes engagés, événement
Expérimentation et essai
« L’erreur est une forme de recherche. »
- Réalise des croquis préparatoires, des essais, des tests techniques (matières, formats, médiums).
- Observe ce qui prend forme et ce qui résiste.
- Note ou photographie chaque étape : cela documente ton cheminement.
- Relie ton intention initiale à tes choix plastiques : composition, format, geste, support, couleur, lumière, espace…
- Vérifie la cohérence entre fond et forme.
Tiens à jour ton carnet de travail (ou journal graphique) : photos, esquisses et notes t’aideront à visualiser ton cheminement, à justifier tes choix.
Après-coup
« Un projet n’existe que lorsqu’il rencontre un regard. »
- Pense au regard du spectateur : Que verra-t-il ? Que comprendra-t-il ? Que ressentira-t-il ?
- Prépare ta présentation (accrochage, installation, exposition) : choix du lieu, disposition, texte d’intention, carnet de travail.
- Mets en valeur ton dossier (photos, croquis, notes, essais).
- Sois prêt à expliquer ton cheminement, pas seulement le résultat.
*La liste d’incitations en pièce jointe peut vous aider à trouver un début d’idée pour votre projet personnel :
Focus sur quelques démarches artistiques
Modalités de l’épreuve orale
Cette partie de l’épreuve prend appui sur la présentation d’un projet abouti à visée artistique et se déroule en deux parties consécutives :
- Première partie : présentation d’un projet
Le candidat présente une ou plusieurs réalisations plastiques et un dossier qui témoignent d’un projet abouti à visée artistique, issu du travail conduit dans le cadre de l’enseignement suivi en classe terminale. Ayant indiqué sommairement les motivations du choix de ce projet parmi d’autres possibles, il en expose les intentions, la démarche, les moyens et les processus mobilisés. Il peut également nourrir sa présentation d’expériences personnelles comme de rencontres qu’il a pu faire avec la création artistique (œuvres, artistes, lieux de création, d’exposition, de conservation, etc.) en s’appuyant, si besoin, sur des éléments de son carnet de travail.
- Deuxième partie : entretien
L’entretien est conduit dans une forme dialoguée favorisant la prise en compte conjuguée du projet présenté (réalisations et dossier) et du carnet de travail. Il permet au candidat un retour critique sur le projet et sur la présentation conduite durant la première partie de l’épreuve. Le jury l’invite à développer et à préciser sa réflexion quant aux partis pris et aux intentions artistiques, aux moyens et aux techniques plastiques mobilisés, ainsi qu’aux possibles influences et esthétiques ayant nourri son travail. Il engage par ailleurs le candidat à approfondir les liens qu’il établit avec sa culture plastique et artistique. En appui sur le carnet de travail, l’entretien permet en outre une meilleure compréhension de son parcours en arts plastiques et une appréciation plus fine de son engagement comme de sa sensibilité artistique.
Projet, dossier, carnet de travail, document de synthèse
Le projet abouti présenté est constitué, en fonction de la nature de la démarche, d’une ou plusieurs réalisations plastiques (dans ce cas, une sélection d’au maximum quatre) et d’un dossier qui le documente. Les réalisations plastiques présentées s’inscrivent, selon le choix du candidat, dans un ou plusieurs des grands types de pratiques définis par les programmes. Le jour de l’épreuve, elles doivent pouvoir être transportées et disposées par le candidat dans la salle d’examen sans aide extérieure ni dispositif particulier d’accrochage ou de présentation. Elles ne sont pas manipulées par le jury.
La restitution des pratiques strictement infographiques, numériques ou vidéographiques comme les visualisations nécessitant le multimédia sont conduites avec du matériel informatique. La photographie et la vidéo sont employées pour restituer les réalisations bidimensionnelles et tridimensionnelles de très grand format ou de très gros volume, ainsi que celles impliquant la durée ou le mouvement, de même que celles en relation à un espace architectural ou naturel, à un dispositif de présentation ou à la réalisation d’une exposition. L’ensemble du visionnement de ces documents doit strictement s’inscrire dans une partie des dix minutes du temps de préparation. Le candidat est responsable du matériel informatique requis et de son bon fonctionnement. Il prévoit des versions imprimées à présenter en cas d’une éventuelle panne.
Le dossier documente le projet. Il comprend des éléments permettant de l’appréhender dans sa globalité comme dans sa dynamique. Par exemple : sélection d’esquisses, de réalisations préparatoires, de photographies pouvant restituer une vue d’ensemble, de traces des évolutions ou des orientations prises ; documents ou échantillons témoignant de certaines caractéristiques plastiques ou des processus de travail ; captations de mises en œuvre ou des monstrations qui, notamment, ne peuvent être apportées le jour de l’épreuve, etc. La forme et les données du dossier sont libres, dans la limite raisonnable de pouvoir être rassemblées et transportées dans un format du type « raisin » et de 5 cm d’épaisseur.
Le carnet de travail est obligatoirement apporté par le candidat le jour de l’épreuve. C’est un objet personnel qui témoigne de la diversité des projets et démarches, des réalisations abouties, inachevées ou en cours, des expériences, des rencontres et des références ayant pu jalonner l’ensemble de l’année de terminale et que l’élève a décidé de retenir ou de valoriser. La forme et les données matérielles du carnet de travail sont libres.
Un document de synthèse, rédigé par le professeur, décrit sommairement en une page, les grandes étapes du travail de la classe et atteste de l’authenticité du projet présenté par le candidat.